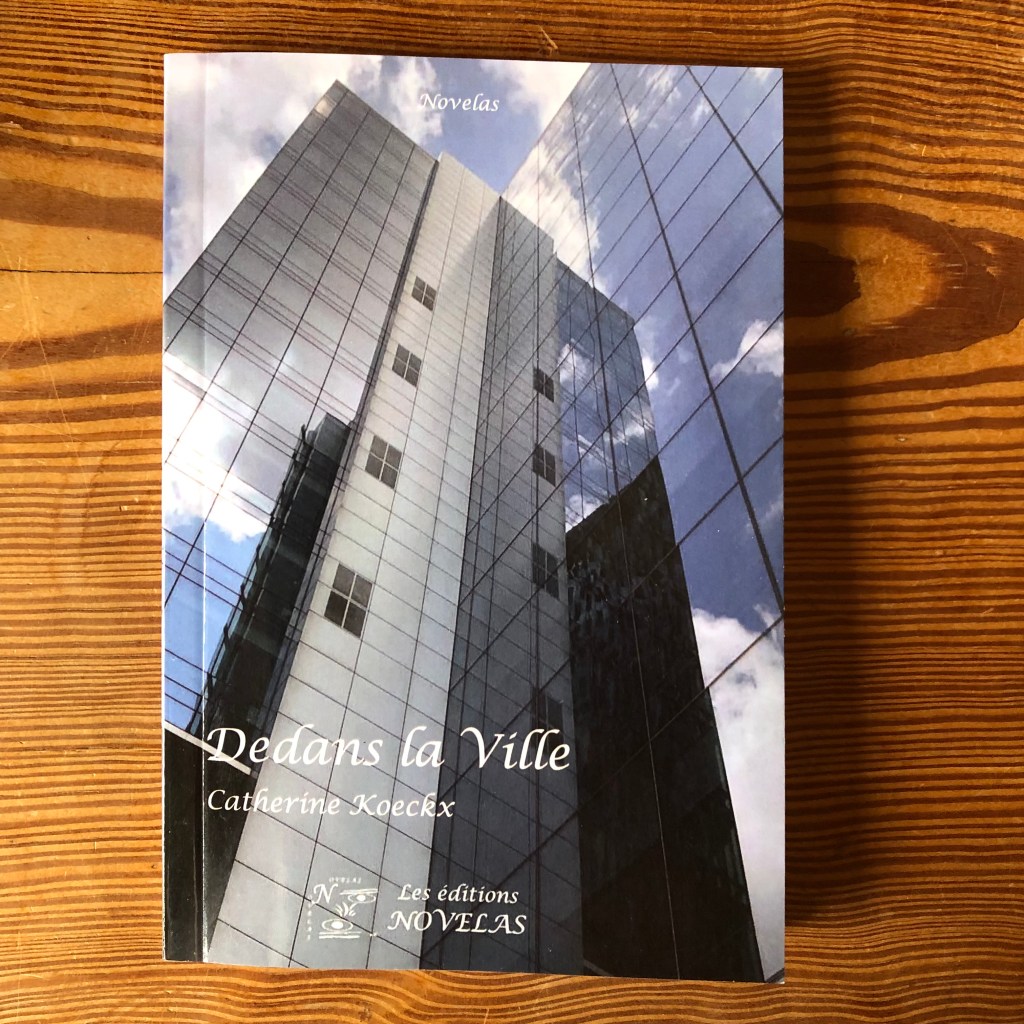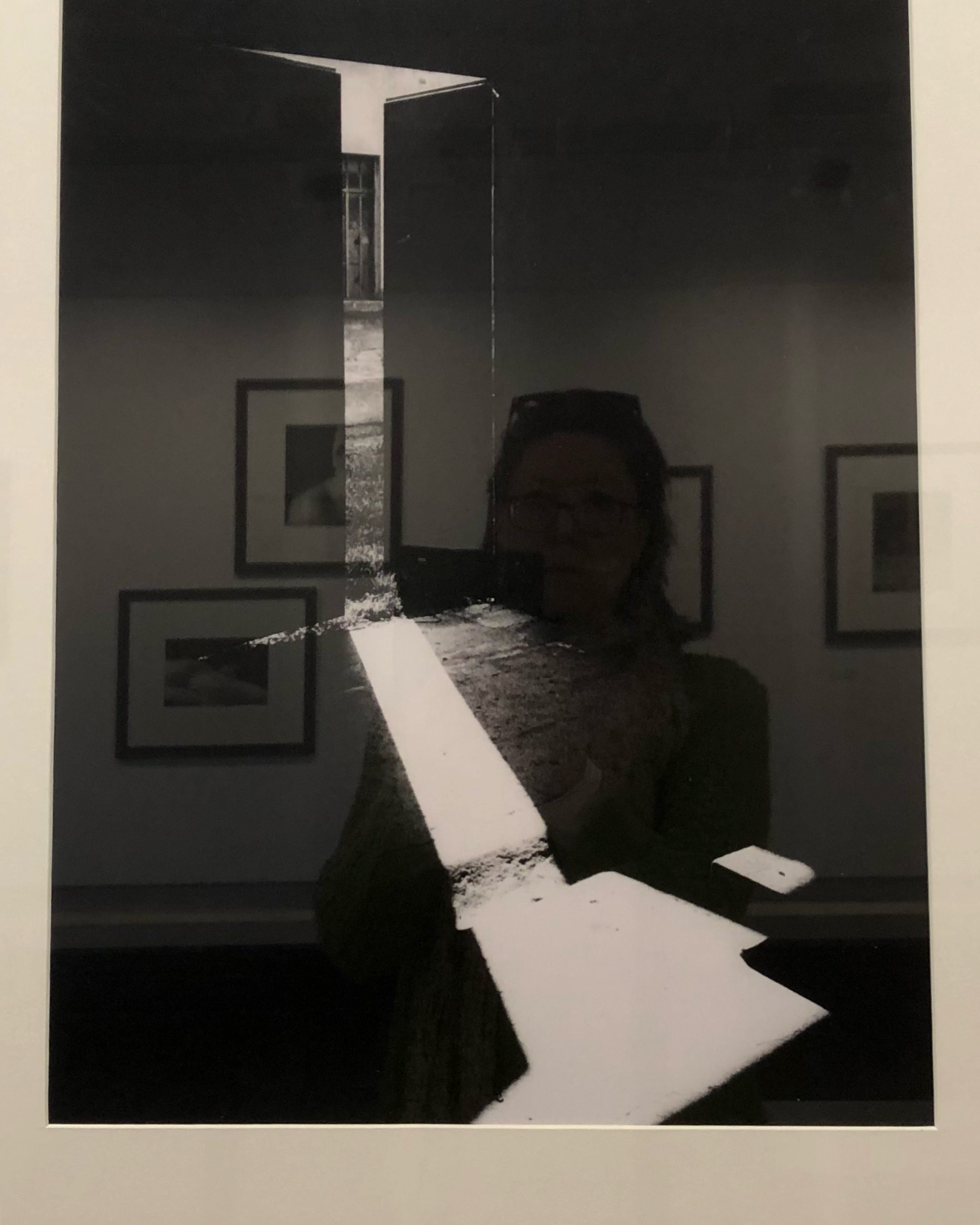Y revenir cinq plus tard. Se revoir à quinze ans rêvant d’aller aux États-Unis et se promettre d’y aller un jour, promesse réalisée en 2018. Y revenir en 2023. N’avoir jamais pensé déambuler un jour seule à New-York comme aujourd’hui, qui plus est à la rencontre de spécialistes de Lovecraft, Derrick Hussey et Peter Cannon. Mémorable. Mais d’abord descendre la 6e Avenue, Avenue of the Americas, capter comme à Bruxelles l’alliance du moderne et de l’ancien, les façades en briques ou en pierre de taille, les pilastres et chapiteaux sculptés, les gargouilles ésotériques et mystérieuses, les rambardes en fer forgé côtoient ce reflet du ciel bleu et des nuages dans les immeubles de verre qui partout te fascine, l’infini éclectisme de la ville. La ville qui t’absorbe et tu as l’impression d’en faire partie, tant New York est la ville qui appartient à tous. Plonger dans East Village, passer de la verticalité de la ville, vertigineuse et grisante, qu’on dirait inhumaine à quelques maisons de modeste dimension, surgies d’on ne sait où, tourner à gauche au niveau de la 13 rue Est et remonter d’une rue, l’immense librairie The Strand, 18 miles de livres. C’est le lieu du rendez-vous avec les lovecraftiens, le New Kalem Club comme ils se nomment informellement avant ça parcourir les rayons de la plus grande librairie indépendante de New York fondée en 1927. Trop touchant d’avoir ainsi été invitée à me joindre à eux lors de leur réunion mensuelle où ils fêtaient l’anniversaire de leur ami le poète Fred Phillips. Plaisir immense d’échanger avec Derrick Hussey, directeur d’Hippocampus Press et avec Peter Cannon, auteur de nombreux essais, romans et nouvelles consacrés et inspirés de Lovecraft et lui offrir Le Guide lovecraftien de Providence.